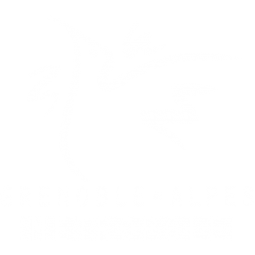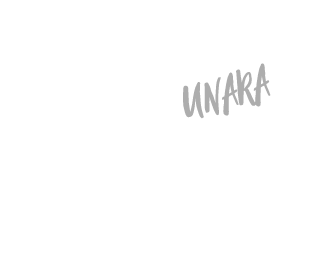Ne soyons pas naïfs. La rue est une micro-société à la marge où les sentiments sont exacerbés. Les rapports se font plus violents, qui répondent à la cruauté d’une situation qui ne l’est pas moins.
Vivre à la rue est une épreuve. Il faut trouver à manger. Trouver où dormir. Où pisser. Où se laver. Les actes du quotidien ne sont plus banals. Ils réclament énergie et investissement. La rue use, quand elle ne tue pas.
Au milieu de cette cruelle réalité, il y a des femmes. Dans ce microcosme où la violence est accrue, la femme est vulnérable, jusque dans sa chair. Elle est statistiquement plus l’objet de rackets qu’un homme. Elle se fait aussi violer plus souvent que les hommes. La rue est un non-lieu (1) où il peut s’avérer dangereux d’exprimer sa féminité.
La rue est une jungle où il ne fait pas bon être une femme
Si près de deux sans-domicile sur cinq sont des femmes, les hommes constituent la quasi-totalité de la population des sans-abri. Il est rare de croiser une femme qui dort dans la rue, soit parce qu’elle se cache, soit parce qu’elle trouve une autre solution. Pourtant pas les centres d’hébergement, souvent mixtes, où elles redoutent de devenir l’objet de violences sexistes voire sexuelles. Il y a 30 000 femmes sans domicile fixe en France (chiffres INSEE, 2012), mais seules un tiers d’entre elles appellent le 115 pour solliciter un hébergement. Pourquoi préfèrent-elles rester à la rue ? Pour beaucoup, les centres d’hébergement mixtes peuvent être le terrain de violences masculines, réelles ou supposées.
Alexia Choquet et Fanny Veillepeau travaillent à l’association Femmes SDF de Grenoble et encadrent les activités du Local des Femmes, un accueil de jour dédié à la gente féminine. Elles nous expliquent que les femmes usent de plus de « stratégies de débrouille » que les hommes. Ce terme cache pourtant une réalité bien scabreuse. Trouver quelqu’un chez qui dormir, « c’est choisir avec qui on va avoir un rapport plutôt que de se faire violer par n’importe qui ».
Des stratégies d’invisibilité
Le quotidien d’une femme à la rue c’est de se sentir « comme un bout de viande ». Une réalité qui oblige à se rendre invisible. Les stratégies d’invisibilité passent par l’apparence physique. Il y a celles qui s’habillent et se maquillent pour passer inaperçu, qui passent leur journée entre deux abris bus. Des femmes que l’on croise sans s’en apercevoir, dont on ne peut deviner le quotidien. À l’opposé, certaines choisissent la masculinité à outrance, tant dans l’apparence que dans le comportement. Certaines vont jusqu’à se salir ou de s’uriner dessus pour faire fuir les « prédateurs ». Fanny Veillepeau prend l’exemple d’une femme qui a choisi la deuxième option : « Elle est allée très loin dans ce processus de masculinisation. Un jour je la croise, elle était alcoolisée. Elle me dit qu’elle n’en revient pas. Elle en était à sa cinquième proposition sexuelle depuis le matin ».
Des problématiques typiquement féminines
Outre ces violences sexistes, les femmes rencontrent des problématiques spécifiques qui rendent leur passage dans la rue particulièrement compliqué. Elles ne peuvent pas exprimer leur féminité, au risque de se mettre en danger ; elles sont pourtant jugées à leur apparence. Alexia Choquet explique : « une femme se doit de répondre à des représentations sociétales par rapport aux apparences, à la maternité. Celle qui ne peut pas s’occuper de ses enfants subit une double peine : sa détresse personnelle et ce miroir de culpabilité ». Il est aisé de constater que les expressions « mauvaise mère » ou « femme de mauvaise vie » n’ont pas leur pendant masculin. La misère au féminin est en soi péjorative.
Si l’on en revient à des contingences tout à fait pragmatiques, les femmes connaissent des difficultés particulières : les pisse-debout ne leur sont pas adaptés ; les protections menstruelles coûtent cher et exigent un accès à une hygiène décente. Ce que la rue n’offre pas.
Corine Masiero, une des actrices principales du films Les Invisibles de Louis-Julien Petit, sorti en janvier dernier, a vécu un temps à la rue. Elle offre dans cette vidéo un témoignage de cette triste réalité :
https://www.youtube.com/watch?v=Yx4RWPgyuIs
Les pouvoirs publics, dépassés, font appel à l’expertise des associations
La société dans son ensemble et les pouvoirs publics en particulier ne savent pas réagir à un phénomène qui prend chaque année plus d’ampleur : 141 500 personnes étaient sans domicile en France métropolitaine début 2012, soit une progression de près de 50 % depuis 2001. Nous n’avons pas de chiffres actualisés mais il suffit d’ouvrir les yeux pour constater qu »il y a de plus en plus de femmes et d’enfants dans les rues. C’est la raison d’être d’associations comme Féminité sans abri ou la Fondation des Femmes au niveau national, ou de Femmes SDF à Grenoble. Ainsi la Mairie de Grenoble, cherchant à installer des boîtes à don pour serviettes hygiéniques, a contacté l’association Femmes SDF pour bénéficier de son expertise. Ces associations échangent en effet directement avec les femmes en galère. Elles écoutent leurs besoins et les associent à la réflexion afin d’envisager ensemble des réponses adaptées.
Féminité sans abri s’occupe notamment de récolter des dons de produits d’hygiène féminine pour les redistribuer lors de maraudes ou les acheminer vers des accueils féminins. Le Local des femmes a ainsi reçu un colis à redistribuer il y a quelques semaines.
L’ensemble des associations milite pour une prise en charge spécifique des femmes, puisqu’elles ont des besoins particuliers. Il s’agit de multiplier les accueils féminins ou d’aménager autrement les espaces mixtes pour qu’elles puissent jouir sinon de plus de plus d’intimité, au moins d’une sécurité vitale. La Fondation des femmes a lancé campagne #UnAbriPourToutes afin de sécuriser les centres d’hébergements et permettre ainsi aux femmes en situation de grande précarité de bénéficier d’une mise à l’abri, en toute sécurité. Cela passe par une phase de diagnostic mais aussi la formation des travailleurs sociaux. Une mixité plus apaisée passe par une phase d’éducation à tous les niveaux.
(1) Marc Augé, anthropologue et ethnologue français, définit le non-lieu comme un espace interchangeable où l’être humain reste anonyme.