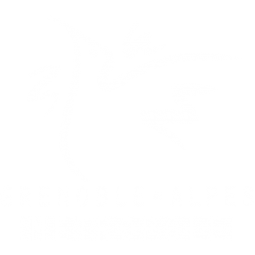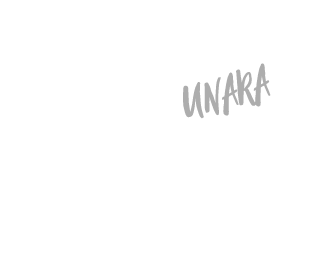Très remarqué dans les médias à sa sortie mercredi 22 janvier, très prochainement visible à Grenoble au cinéma Le Méliès, le film-documentaire Au bord du monde de Claus Drexel donne la parole à des SDF parisiens, soulignant le contraste entre la beauté de la capitale et la misère noire de certains de ses habitants, de ses « exclus ».
Paris by night
Paris la nuit, Paris by night, la Seine aux reflets d’or, les ponts majestueux, les gargouilles de Notre-Dame et la Tour Eiffel, la bergère d’Apollinaire qui semble un phare trônant au sein de la plus belle ville du monde, la cité-lumière, paradis romantique des amoureux et des touristes, célébrée par tant de peintres, de chanteurs, de cinéastes.
Et puis ses clochards. Ses sans-abri. Ses SDF. Ses miséreux. Qui dorment dans des tentes entre deux boulevards, dans une cabane en carton fabriquée dans un coin de parking, ou simplement par terre, à la belle étoile.
Est-ce pour mieux souligner ce paradoxe entre la beauté de nos villes et la misère de certains qui la peuplent que Claus Drexel a choisi de filmer Paris ? En tout cas le contraste est saisissant, il étouffe presque. Paris la nuit offre des rues désertes, des paysages solitaires au sein desquels se déplacent des « fantômes » comme dit l’un d’entre-eux. Toute leur vie sur le dos, ou dans le chariot de supermarché qu’ils poussent devant eux.
Drexel ne filme que les sans-abri. Si l’on devine quelques passants, ce ne sont que des ombres qui se profilent à la lumière d’un lampadaire. Et les trois policiers qui enjoignent le Roumain Costel, avec dans le ton un étrange mélange de courtoisie, de commisération et d’autoritarisme, de quitter le pont sous lequel il a trouvé refuge, ils ne sont que trois silhouettes qui s’éloignent et finissent par disparaître. Il n’est question ici que de donner la parole à ceux que l’on n’écoute d’ordinaire jamais. Et tous ont quelque chose à dire.
« Y en a qui tombent »
Dans le ton de la conversation, sans les soumettre à un flot ininterrompu de questions, en leur laissant toujours le temps de répondre ou même de se taire, Drexel recueille ainsi les témoignages et les impressions de ces exclus, de ces gens tellement nombreux qu’ils en sont devenus invisibles. Le film est un long dialogue avec des tranches de vie, avec des histoires complexes, avec des existences difficiles, sans jamais sombrer ni dans le pathétique, ni dans le misérabilisme.
Il n’est pas question non plus de diriger les propos, et de fait le réalisateur filme et enregistre des personnes qu’aucune émission de télévision, dans le cadre d’un documentaire, ne prendrait la peine de laisser s’exprimer. Le discours de Jeni est incohérent, saute du coq à l’âne sans jamais parvenir à se fixer sur une idée précise, et dénote clairement des soucis d’ordre psychiatrique. Celui de Michel se répète, tourne en rond, a du mal à s’accrocher à une conclusion. Drexel les restitue tels quels. Il ne coupe pas, et n’intervient pas.
Il n’investigue pas non plus : on ne saura pas pourquoi Christine est à la rue, quelle est cette agression dont elle dit avoir été victime, ce qu’est devenu son mari ou ses enfants. Le sujet n’est pas de raconter pourquoi ou comment quelqu’un peut se retrouver à vivre ainsi. Pas de pente fatale, pas de message moralisateur sur le thème « cela peut arriver à tout le monde ». Qu’en est-il, simplement, lorsque c’est arrivé ? Et comment le vit-on ? S’il y a un message dans ce film, c’est celui porté par les intervenants eux-mêmes.
« C’est même plus la peine d’écouter »
Par Alexandre, qui considère que l’humanité régresse et que seule la technologie évolue, et voit le futur comme un monde extrêmement sophistiqué qui sera habité par des hommes préhistoriques. Par Wenceslas, à la voix douce et posée, qui livre avec une étrange simplicité et de la poésie parfois sa vision des choses, de la vie et des oiseaux, sans colère ni indignation même lorsqu’il confie qu’il en a « ras-le-bol à fond ». Ou par Marco, qui évoque Coluche et l’Abbé Pierre et estime que depuis que l’un et l’autre sont morts, c’est « la débandade ».
Chacune des personnes qui viennent illustrer ce film pas comme les autres semble évoluer dans une ville morte et bien souvent silencieuse, si l’on excepte le flot incessant des voitures et les sirènes des pompiers ou des policiers. Chacune est un îlot d’humanité dans un vaste paysage de carte postale. Une humanité que certains ne veulent pas, ou plus voir. Que certains rejettent en la considérant « inutile ». Plus que jamais, alors que le fameux appel de l’Abbé Pierre aura soixante ans au mois de février de cette année, la question des sans-abri se pose. Elle se pose de manière criante, insupportable, assourdissante et donc, pour beaucoup, inaudible.
Pascal estime que c’est au début qu’il fallait faire quelque chose, quand les sans-abri n’étaient encore qu’une centaine, qu’à présent les voici des milliers et que le problème semble insoluble. Pendant que Christine, elle, explique que ce qui lui est le plus insupportable dans le fait de vivre dans la rue, c’est la « non-réponse » que sa situation engendre. Mais elle ne sait pas appeler à l’aide, dit-elle. Et en effet, à part les nombreuses associations qui ne peuvent qu’alléger les difficultés au quotidien, qui lui viendra en aide ? Où est la volonté politique ? Existe-t-elle simplement ?

« Vivre dehors, ça casse, ça use et ça tue »
Les SDF sont un sujet qui refait surface à la faveur d’un coup de froid, d’une jospinade absurde (« zéro SDF en 2007 ») ou d’un film à succès signé Jugnot, mais que l’on s’empresse de cacher sous le tapis et d’oublier avec application. Drexel donne la parole, donne un visage, donne une image à quelques-uns d’entre-eux. Il sort de la logique des chiffres, du sensationnalisme ou du pathos pour livrer un véritable objet de cinéma et rappeler une intolérable réalité.
Et l’on ne sait plus, lorsque le film se conclut sur une mélodie de Puccini, si ce sont les notes de Nessun dorma ou les portraits morcelés que l’on vient de nous délivrer qui nous font ainsi monter les larmes aux yeux.