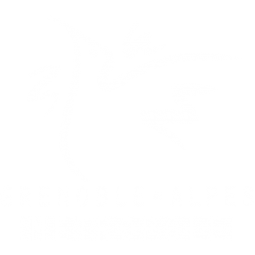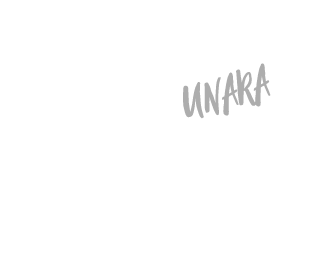Mercredi 5 février à 20 heures au Méliès, Claus Drexel viendra présenter devant le public de Grenoble, une ville qu’il connaît très bien pour y avoir grandi, son film Au bord du monde.
Le documentaire, qui donne la parole aux sans-abri parisiens, sera ensuite visible durant deux semaines sur les écrans du cinéma de la Caserne de Bonne. Très pris par l’actualité de son film et ses rencontres avec les spectateurs, son réalisateur a toutefois pu nous accorder un peu de son temps pour répondre à quelques questions.
Le Bon Plan — On peut penser qu’il y a deux tabous au cinéma : on ne montre pas de vieux, et on ne montre pas de SDF. A-t-il été difficile de monter le projet d’un film donnant dans son intégralité la parole à des sans-abri ?
Claus Drexel — Ce qui fait vraiment souffrir notre société, c’est que l’on considère les gens en fonction de leur rentabilité. Les SDF, comme les vieux, ne sont pas rentables, et du coup on leur enlève toute dignité. C’était donc la raison d’être du film : leur donner la parole et montrer que ce sont des gens qui ont autant de valeur que n’importe qui. C’était vraiment la volonté de départ. Et pour le financement, je rends un immense hommage à mon producteur, Florent Lacaze, un gars absolument incroyable qui a financé intégralement le film de A à Z, de sa poche. Nous avons reçu une aide du CNC, mais seulement après que le film ait été réalisé. Les producteurs font certainement un excellent boulot mais ils ne veulent plus financer un film s’ils n’ont pas d’aides derrière, et souvent ils ne font plus que remplir les carnets de commande des chaînes de télévision, en s’amputant de ce qui fait la part la plus belle de leur métier. Il n’y a quasiment plus personne qui prend des risques, comme l’a fait Florent.
Dans ce film, la parole n’est donnée qu’aux personnes sans-abri, sans commentaires ou voix-off, à cent lieues d’un documentaire de télévision, dans le fond comme dans la forme.
Je suis parti en faisant la démarche inverse de celle d’un journaliste : je ne me suis pas documenté ou renseigné sur ce monde-là, parce que je ne voulais pas être marqué par des préconçus. Je me faisais l’idée d’être un extraterrestre arrivant à Paris la nuit et découvrant le monde en fonction des gens qu’il rencontre. Je n’ai rien contre la télévision, mais avec elle il faut toujours entrer dans des cases : faire cinquante-deux minutes, pour prévoir huit minutes de publicité… Avec mon producteur, on a voulu faire un film de cinéma, ayant la durée qu’il doit avoir. Le film aurait pu faire une heure douze comme deux heures et trois minutes. Il en fait une heure trente-huit parce que c’est la durée qu’il nous a semblé devoir avoir, en fonction de la parole qui nous a été offerte.
Les personnes sans-abri que vous avez rencontrées vivent dans des conditions de dureté extrême sans forcément donner l’impression d’en avoir elles-mêmes conscience.
Effectivement, ils ne sont pas révoltés, ils disent ne pas avoir besoin de grand-chose, et c’est pour moi une véritable leçon de vie. Ce sont les plus démunis d’entre nous tous qui nous disent que l’essentiel n’est pas l’argent, le luxe ou la croissance, ce que l’on n’arrête pas de nous répéter dans les médias. Ce sont eux qui nous disent que le plus important, c’est l’amitié, c’est le partage ou l’amour. Nous sommes dans une époque où plus personne ne prend le temps de réfléchir. Il faut le téléchargement immédiat, il faut que la connexion Internet soit plus rapide, il faut en permanence que les choses aillent vite… Eux, en revanche, passent leur journée à réfléchir. Ils sont un peu les derniers philosophes de notre société, les derniers gardiens de la ville-lumière. Ils savent que l’on peut vivre avec peu, que ce n’est pas la consommation qui rend heureux, et que le plus important c’est le lien social ou familial.
Les sans-abri qui apparaissent dans ce film ont-ils pu le voir ? Avez vous eu des retours de leur part ?
La projection à leur intention était pour moi la plus importante de toutes. Mais après avoir ressenti une émotion très violente durant la première projection publique du film pendant le Festival de Cannes, j’ai pensé que cela serait encore plus violent pour eux, voire dangereux. J’ai pensé qu’on ne pouvait pas leur montrer le film n’importe comment. On a donc organisé des projections dans des cadres familiers, tels que l’église Saint-Leu ou la Maison de Nanterre, mais on s’est rendu compte qu’ils n’avaient pas tellement envie de venir. Certains l’ont vu, mais la plupart ont jugé que ce n’était pas la peine, que l’essentiel était d’avoir été écouté.
On retrouve l’humilité…
Ils n’ont évidemment pas fait le film dans une logique de se montrer. Vers la fin du tournage, il n’était pas question pour nous de disparaître du jour au lendemain, mais je les prévenais que nous allions venir moins souvent et leur demandais s’ils avaient besoin de quelque chose, d’un peu d’argent, d’une tente, de vêtements… Quasiment tous m’ont répondu : tu nous as écouté, c’est ça l’essentiel. C’est ce moment d’écoute et de partage qui était important pour eux. Ce qu’il leur manque vraiment, c’est ce contact humain. L’enseignement du film, c’est l’importance de garder ce lien humain entre nous. Je ne veux pas minimiser les autres problèmes comme celui du logement, mais c’est la relation humaine qui reste plus importante que tout.
Vous présentez le film un peu partout en France en ce moment. Avez-vous des bons retours et, plus prosaïquement, est-ce que le film marche ?
Comme le film est un documentaire, il a démarré dans peu de salles. Mais comme je vais beaucoup à la rencontre du public je vois que les salles sont de plus en plus pleines, en plus d’un soutien de la presse inouï, et c’est quelque chose qui me donne vraiment espoir. Moi qui avais une vision assez pessimiste de notre monde, cela me rassure de voir beaucoup de gens interpellés et touchés par un film qui met ainsi l’humain au centre. C’est une grande source d’espoir !